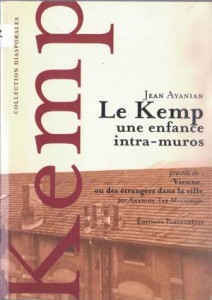 Cet article a été préparé à partir d’extraits du texte “Vienne ou des étrangers dans la ville”, que l’historienne Anahide Ter Minassian a rédigé pour le livre de Jean Ayanian “Le kemp, une enfance intra-muros” (Edtions Paretnthèses).
Cet article a été préparé à partir d’extraits du texte “Vienne ou des étrangers dans la ville”, que l’historienne Anahide Ter Minassian a rédigé pour le livre de Jean Ayanian “Le kemp, une enfance intra-muros” (Edtions Paretnthèses).
La Ville
Vienne s’est développée à la confluence d’un méandre, harmonieux et ample, du Rhône et de l’étroite vallée de la Gère, rivière née sur le plateau, et dont le cours torrentiel à partir de Pont-Evêque est dû aux cent mètres de dénivelée entre le fond de la vallée et le plateau. Appuyée sur le Pipet, entouré de buttes plus ou moins détachées – les fameuses “sept collines” -, protégé au nord par le profond fossé de la Gère et à l’ouest par le Rhône difficile à franchir, le site de Vienne a une valeur défensive : elle est reconnue d’abord par les Allobroges qui la choisirent pour capitale, puis par les Romains qui la renforcèrent par des murailles. Ces derniers construisirent un pont sur le Rhône pour faire de Vienne un noeud routier, un centre de navigation fluviale, mais surtout un centre administratif et un foyer intellectuel et artistique.
Au Moyen Age, Vienne bénéficie de l’activité de son arrière-pays rural, accueille des foires et se couvre de monuments : l’église Saint-Pierre, la plus ancienne, associée à la légende de Saint Mamaire, les églises Saint-André-le-Bas et Saint-André-le-Haut, le château de la Bâtie, la magnifique cathédrale Saint-Maurice.
Après une longue dépression, l’apparition de la draperie au 18e siècle dans la vallée de la Gère, rivière aux eaux toujours vives, où existent déjà des moulins et des forges, détermine sa vocation industrielle. La draperie entraîne la création d’une Manufacture royale (1763) et fixe une première population ouvrière. Durant la Révolution et l’Empire, les drapiers viennois fabriquent des draps de troupe pour les armées françaises et, en 1820, la ville compte déjà 4 000 ouvriers. Au 19e siècle et sa révolution industrielle, les eaux de la Gère sont domestiquées et alimentent écluses, chutes et roues de moulins à eau pour fournir l’énergie hydraulique avant la généralisation des machines à vapeur, à partir de 1860. Ses rives, encaissées entre des collines verdoyantes, se couvrent d’usines, de fours, de cheminées, de bâtiments rustiques ou modernes qui ont inspiré l’oeuvre de peintres “paysagistes industriels” dont le plus connu est Louis-Etienne Watelet.
Dans les années vingt, la draperie, avec ses différentes étapes de fabrication – filature, teinture, tissage – domine l’économie locale. Elle aligne 2 000 métiers, utilise annuellement 6 500 tonnes de matières premières, produit 130 000 pièces de draps, fait travailler 7 500 ouvriers. Depuis la fin de la guerre, le remplacement des draps Renaissance par des draps fins et des draps imprimés démontre la capacité des industriels viennois à s’adapter à l’évolution du marché et aux goûts de la clientèle. L’industrie drapière a encore quelques belles années devant elle et, pour l’heure, elle a besoin d’une main-d’oeuvre nombreuse, peu qualifiée et peu exigeante. Le recensement de 1926 a dénombré à Vienne 24 500 habitants, presque 10 000 d’entre eux sont ouvriers. C’est dans ce cadre urbain et industriel, et c’est dans ce monde ouvrier, que les premiers Arméniens ont été introduits.
D’où viennent ces immigrés des années vingt ?
Dans les limités frontalières de la Turquie moderne fixées par le traité de Lausanne (1923), il existait un pays qui s’appelait l’Arménie et dont les habitants étaient les Arméniens. Situé à l’est de l’Asie mineure, le Plateau arménien, un ensemble de plateaux étagés de 900 à 2 000 m et épaulés par de hautes chaînes de montagnes, est dominé par le mont Ararat (5 172 m) et scié par de profondes vallées qui compartimentent le pays.
Sa position stratégique en a fait longtemps un carrefour de routes commerciales et de voies d’invasions. Durant vingt-cinq siècles, l’Arménie a été mentionnée dans les archives assyriennes, babyloniennes, mèdes, perses, grecques, romaines, parthes, byzantines, arabes, mongoles, russes, ottomanes, dans les chroniques des Croisés et les récits des voyageurs de l’époque moderne et contemporaine. Vieux peuple, habitants d’un pays où, selon la Bible, l’humanité a pris un second départ après le l’épisode du Déluge, les Arméniens ont connu dans leur histoire trimillénaire des phases d’indépendance et de dépendance.
Au début du 19e siècle, les Arméniens, ainsi que le Plateau arménien, sont partagés entre trois Empires : ottoman, russe et perse. Traits significatifs et lourds de conséquences sur le plan politique : les Arméniens sont devenus une population transfrontalière et ils ne disposent plus d’un vrai territoire national.
De 1878 à 1914, la Question arménienne, internationalisée au 19e siècle dans le cadre de la Question d’Orient, en reproduit le paradigme : situation d’oppression d’une minorité chrétienne de l’Empire ottoman soumise, comme les autres sujets non musulmans de l’Empire, à des interdictions légales et à des obligations fiscales particulières; influence de la Révolution française et des révolutions européennes de 1830 et de 1848; renaissance culturelle arménienne; expansion russe vers l’Orient; rivalités et interventions des puissances exacerbées à l’heure de l’impérialisme. Promises par l’article 61 du traité de Berlin (1878), les réformes à accomplir dans les “provinces habitées par les Arméniens” n’ont jamais été appliquées et les massacres de 1894-1896, qui répondent aux revendications des Arméniens, traités comme des sujets révoltés, n’ont entraîné que des protestations de pure forme de la part des Etats occidentaux.
Déclenchées en avril 1915, sur l’ordre du triumvirat au pouvoir – les ministres Talaat, Enver et Djémal – les déportations dans les déserts de Syrie et de Mésopotamie, combinant les marches forcées, les privations alimentaires et les massacres collectifs, entraînent la disparition, dans des conditions atroces, de 50 à 60% de la population arménienne. Le génocide de 1915, le premier des génocides du 20e siècle, a été une catastrophe sans précédent dans l’histoire du peuple arménien : c’est un “évènement-matrice” d’où naîtra la diaspora. De 1915 à 1923, date du traité de Lausanne qui révise le traité de Sèvres et reconnaît la Turquie moderne, on assiste à la dispersion de quelque 700 000 réfugiés. Les Alliés avaient gratifié les Arméniens, durant la guerre, de promesses nombreuses. Mais ils ne firent pas, sauf en Cilicie que la France rétrocéda à Mustafa Kémal en 1921, d’efforts sérieux pour obtenir du gouvernement turc la restitution de leurs biens. Recueillis dans les orphelinats d’Orient dus à la philanthropie américaine et internationale, parqués et secourus dans des camps, dotés d’un “passeport Nansen”, preuve de leur “apatridie”, les réfugiés arméniens contribuèrent ainsi à l’une des premières expériences de “diplomatie humanitaire”.
Les Arméniens à Vienne
L’arrivée des Arméniens à Vienne s’inscrit dans la grande vague d’immigration en France des réfugiés en provenance de la Syrie et du Liban, pays sous mandat français, et de la Turquie, principal Etat successeur de l’Empire ottoman. Certains ont déjà fait un bref séjour en Grèce et dans les îles grecques, et même en Bulgarie et en Roumanie. En collaboration avec l’explorateur norvégien, Fridjof Nansen, nommé par la Société des Nations à la tête du Haut Commissariat pour les Réfugiés, le Bureau International du Travail (BIT), autre organisme de la SDN, dirigée par le socialiste Albert Thomas, s’occupe activement de caser les réfugiés arméniens, russes ou hongrois dans les pays en quête de main-d’oeuvre comme la France, saignée par les hécatombes de la Grande Guerre.
Ces réfugiés sont recrutés sur place par des commissionnaires d’entreprises françaises à la recherche d’une main-d’oeuvre endurante et docile, sans qualification particulière. Ainsi la SLSA (Société lyonnaise de soie artificielle) embauche hommes et femmes pour son usine de Décines et jette les bases de l’actuelle communauté arménienne de la périphérie lyonnaise. Dans ce cas, commun à un certain nombre d’entreprises textiles ou minières du sillon rhodanien, l’embauche a été précédée par la signature d’un contrat de travail, rédigé d’après des contrats-types établis par l’administration. Généralement le travailleur s’engage pour un an ou plus et l’employeur, quant à lui, s’engage à fournir un salaire, un logement, voire parfois même de la nourriture et des soins médicaux. Mais, attirés par un parent ou un compatriote, alléchés par la “liberté de travail” et la perspective d’un salaire régulier, bien des Arméniens sont arrivés en France par leurs propres moyens.
A Vienne, il est admis que c’est la direction de l’entreprise des chaussures Pellet, “Manufacture des chaussures cousues à la main” dit son papier commercial, qui, la première, a recruté à Marseille, en 1922, des ouvriers arméniens, sur la foi de leur réputation d’artisans qualifiés. A Vienne, la tendance à la baisse de la population a été accentuée par la Première Guerre Mondiale. Pour compenser les saignées en termes de main-d’oeuvre, puis l’exode des populations rurales du Bas-Dauphiné, traditionnellement pourvoyeuses d’ouvriers, de préférence vers Lyon et déjà vers Grenoble, les industriels viennois n’hésitent pas à importer, durant les années vingt et jusqu’en 1931, des travailleurs étrangers.
Le recensement de 1926 repère 4 169 Arméniens dans la région Rhöne-Alpes et 415 à Vienne. Dans l’ensemble c’est une population “d’adultes-jeunes” -entre 20 et 25 ans- dans laquelle l’élément masculin est prépondérant, le mariage extra-communautaire inconnu et la natalité forte. C’est aussi une population ouvrière à fort taux d’activité : les Arméniens ont été importés à Vienne pour travailler, eh bien ils travaillent ! Ainsi, 75% de la population masculine est active et 53% de la population féminine. L’entreprise de chaussures Pellet emploie 115 Arméniens; les Etablissements Réunis et Dyant, deux entreprises de tissage et de teinture, emploient 103 ouvriers arméniens des deux sexes.
Leurs premières installations, parfois à deux ou trois familles dans une seule pièce, ont eu lieu dans les misérables maisons des rues et des ruelles voisines de l’usine Pellet, dont les friches industrielles sont encore visibles sur la rive droite de la Gère. Les Arméniens commencent par s’entasser dans les vieux immeubles du quai Anatole France, de la rue de la Gère, de la rue Albert Thomas, de la rue Girard, de la place de l’Affûterie, de la rue Victor Faugier et de l’interminable rue Lafayette. Le recensement de 1926 révèle que 39 “ménages” arméniens, comprenant 109 individus, sont concentrés au n° 119 de la rue Lafayette. Ce sont les familles des ouvriers de Pellet. Ce sont “ceux de Lafayette”, une communauté dont l’identité est renforcée lorsque la direction de l’entreprise décide de rénover un de ses bâtiments industriels pour y loger ses ouvriers. Baptisé “maisons neuves”, cet ensemble de deux étages, qui existe toujours, est le dernier de la rue Lafayette et reçoit le n° 150.
A plus d’une heure de marche du “150”, le long du Rhône et dans le faubourg d’Estressin au nord de Vienne, une autre zone d’habitat arménien est aussi constituée en 1926. Elle se trouve vers le quai Pajot, dans la rue du Viaduc, la rue Tuilerie, la rue Druge, sur la place d’Arpôt, dans la rue Francisque Bonnier et la rue Peyssonneau. C’est un autre monde, celui des ce ceux qui travaillent “chez Pascal”, une formule familière qui exprime le forte relation liant le patron de la firme Pascal-Valluit à ses salariés. C’est là, avec son unique entrée rue Peysonneau, que se trouve le Kemp. Dans les liste nominales du recensement de 1926, qui donnent une véritable photographie des premiers occupants du Kemp, ils sont 149, répartis en 66 “ménages”.
La mobilité et la dispersion dans le centre ville, comme le départ définitif pour d’autres villes de la région de “ceux du kemp” ou de “ceux de Lafayette”, ont précédé ou accompagné leur émancipation de l’usine et de l’emprise du patronat local, grâce au travail à domicile, grâce à l’ouverture d’une échoppe de cordonnier, d’un modeste atelier de coiffure ou d’un petit commerce. Paradoxalement, la crise économique des années trente en France, génératrice d’un chômage sévère, en touchant les ouvriers étrangers – les premiers à être débauchés – devait, à terme, avoir des conséquences positives, du moins pour les plus jeunes ou les plus chanceux. Ainsi, le métier de marchand forain, malgré des débuts difficiles et des gains aléatoires, a signifié une forme de liberté, et a favorisé l’individualisme et l’esprit d’entreprise familial qui ont permis l’ascension sociale des Arméniens de la génération suivante. Il est vrai que par ailleurs la disparition des industries textiles à Vienne, dans les années soixante et soixante-dix, puis de toutes les autres industries, devait mettre fin à l’ancien monde ouvrier.
A vienne, comme dans les autres lieux de concentration des réfugiés arméniens, les premières tentatives d’organisation communautaire datent du début des années vingt. Sujets d’une histoire particulière, réduits aux yeux des Français à leur seule fonction d’individus producteurs – et cela se vérifie particulièrement dans les villes industrielles du sillon rhodanien – les Arméniens ont transféré en France, en procédant aux reclassements nécessaires, leurs principales institutions de l’époque ottomane : Eglise, partis, associations. En s’adaptant à la législation locale, en utilisant les ressources de la loi de 1901 sur les associations et, ainsi, en se “modernisant”, elles vont constituer jusqu’à nos jours “l’appareillage” interne des communautés éparses.
Etrangers de naissance, apatrides, les Arméniens de Vienne des années vingt, trente et quarante appartiennent à une autre époque et à d’autres lieux. Ceux de ce début du 21e siècle sont des Français d’origine arménienne, qui ont acquis une grande visibilité dans la ville, bien que, en un demi-siècle, tous les facteurs de l’intégration et de la francisation aient transformé ces immigrés d’un autre temps.
————————————-
Comme nous l’avons précisé plus haut, cet article a été préparé à partir d’extraits du texte “Vienne ou des étrangers dans la ville”, que l’historienne Anahide Ter Minassian a rédigé pour le livre de Jean Ayanian “Le kemp, une enfance intra-muros”.